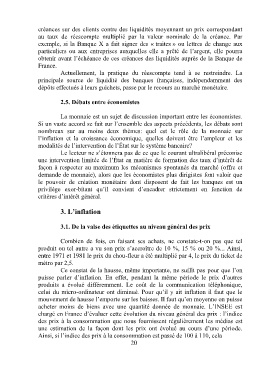Page 22 -
P. 22
créances sur des clients contre des liquidités moyennant un prix correspondant
au taux de réescompte multiplié par la valeur nominale de la créance. Par
exemple, si la Banque X a fait signer des « traites » ou lettres de change aux
particuliers ou aux entreprises auxquelles elle a prêté de l’argent, elle pourra
obtenir avant l’échéance de ces créances des liquidités auprès de la Banque de
France.
Actuellement, la pratique du réescompte tend à se restreindre. La
principale source de liquidité des banques françaises, indépendamment des
dépôts effectués à leurs guichets, passe par le recours au marché monétaire.
2.5. Débats entre économistes
La monnaie est un sujet de discussion important entre les économistes.
Si un vaste accord se fait sur l’ensemble des aspects précédents, les débats sont
nombreux sur au moins deux thèmes: quel est le rôle de la monnaie sur
l’inflation et la croissance économique, quelles doivent être l’ampleur et les
modalités de l’intervention de l’État sur le système bancaire?
Le lecteur ne s’étonnera pas de ce que le courant ultralibéral préconise
une intervention limitée de l’État en matière de formation des taux d’intérêt de
façon à respecter au maximum les mécanismes spontanés du marché (offre et
demande de monnaie), alors que les économistes plus dirigistes font valoir que
le pouvoir de création monétaire dont disposent de fait les banques est un
privilège exor-bitant qu’il convient d’encadrer strictement en fonction de
critères d’intérêt général.
3. L’inflation
3.1. De la valse des étiquettes au niveau général des prix
Combien de fois, en faisant ses achats, ne constate-t-on pas que tel
produit ou tel autre a vu son prix s’accroître de 10 %, 15 % ou 20 %... Ainsi,
entre 1971 et 1981 le prix du chou-fleur a été multiplié par 4, le prix du ticket de
métro par 2,5.
Ce constat de la hausse, même importante, ne suffit pas pour que l’on
puisse parler d’inflation. En effet, pendant la même période le prix d’autres
produits a évolué différemment. Le coût de la communication téléphonique,
celui du micro-ordinateur ont diminué. Pour qu’il y ait inflation il faut que le
mouvement de hausse l’emporte sur les baisses. Il faut qu’en moyenne on puisse
acheter moins de biens avec une quantité donnée de monnaie. L’INSEE est
chargé en France d’évaluer cette évolution du niveau général des prix : l’indice
des prix à la consommation que nous fournissent régulièrement les médias est
une estimation de la façon dont les prix ont évolué au cours d’une période.
Ainsi, si l’indice des prix à la consommation est passé de 100 à 110, cela
20