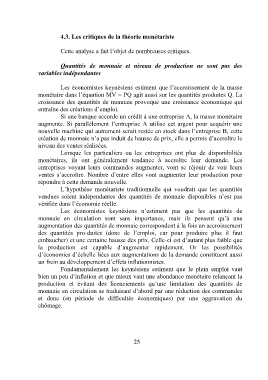Page 27 -
P. 27
4.3. Les critiques de la théorie monétariste
Cette analyse a fait l’objet de nombreuses critiques.
Quantités de monnaie et niveau de production ne sont pas des
variables indépendantes
Les économistes keynésiens estiment que l’accroissement de la masse
monétaire dans l’équation MV = PQ agit aussi sur les quantités produites Q. La
croissance des quantités de monnaie provoque une croissance économique qui
entraîne des créations d’emploi.
Si une banque accorde un crédit à une entreprise A, la masse monétaire
augmente. Si parallèlement l’entreprise A utilise cet argent pour acquérir une
nouvelle machine qui autrement serait restée en stock dans l’entreprise B, cette
création de monnaie n’a pas induit de hausse de prix, elle a permis d’accroître le
niveau des ventes réalisées.
Lorsque les particuliers ou les entreprises ont plus de disponibilités
monétaires, ils ont généralement tendance à accroître leur demande. Les
entreprises voyant leurs commandes augmenter, vont se réjouir de voir leurs
ventes s’accroître. Nombre d’entre elles vont augmenter leur production pour
répondre à cette demande nouvelle.
L’hypothèse monétariste traditionnelle qui voudrait que les quantités
vendues soient indépendantes des quantités de monnaie disponibles n’est pas
vérifiée dans l’économie réelle.
Les économistes keynésiens n’estiment pas que les quantités de
monnaie en circulation sont sans importance, mais ils pensent qu’à une
augmentation des quantités de monnaie correspondent à la fois un accroissement
des quantités pro-duites (donc de l’emploi, car pour produire plus il faut
embaucher) et une certaine hausse des prix. Celle-ci est d’autant plus faible que
la production est capable d’augmenter rapidement. Or les possibilités
d’économies d’échelle liées aux augmentations de la demande constituent aussi
un frein au développement d’effets inflationnistes.
Fondamentalement les keynésiens estiment que le plein emploi vaut
bien un peu d’inflation et que mieux vaut une abondance monétaire relançant la
production et évitant des licenciements qu’une limitation des quantités de
monnaie en circulation se traduisant d’abord par une réduction des commandes
et donc (en période de difficultés économiques) par une aggravation du
chômage.
25