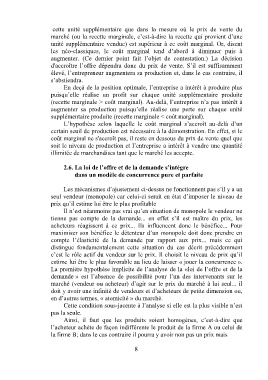Page 10 -
P. 10
cette unité supplémentaire que dans la mesure où le prix de vente du
marché (ou la recette marginale, c’est-à-dire la recette qui provient d’une
unité supplémentaire vendue) est supérieur à ce coût marginal. Or, disent
les néo-classiques, le coût marginal tend d’abord à diminuer puis à
augmenter. (Ce dernier point fait l’objet de contestation.) La décision
d'accroître l’offre dépendra donc du prix de vente. S’il est suffisamment
élevé, l’entrepreneur augmentera sa production et, dans le cas contraire, il
s’abstiendra.
En deçà de la position optimale, l’entreprise a intérêt à produire plus
puisqu’elle réalise un profit sur chaque unité supplémentaire produite
(recette marginale > coût marginal). Au-delà, l’entreprise n’a pas intérêt à
augmenter sa production puisqu’elle réalise une perte sur chaque unité
supplémentaire produite (recette marginale < coût marginal).
L’hypothèse selon laquelle le coût marginal s’accroît au-delà d’un
certain seuil de production est nécessaire à la démonstration. En effet, si le
coût marginal ne s'accroît pas, il reste en dessous du prix de vente quel que
soit le niveau de production et l’entreprise a intérêt à vendre une quantité
illimitée de marchandises tant que le marché les accepte.
2.6. La loi de l’offre et de la demande s’intègre
dans un modèle de concurrence pure et parfaite
Les mécanismes d’ajustement ci-dessus ne fonctionnent pas s’il y a un
seul vendeur (monopole) car celui-ci serait en état d’imposer le niveau de
prix qu’il estime lui être le plus profitable
Il n’est néanmoins pas vrai qu’en situation de monopole le vendeur ne
tienne pas compte de la demande... en effet s’il est maître du prix, les
acheteurs réagissent à ce prix... Ils influencent donc le bénéfice... Pour
maximiser son bénéfice le détenteur d’un monopole doit donc prendre en
compte l’élasticité de la demande par rapport aux prix... mais ce qui
distingue fondamentalement cette situation du cas décrit précédemment
c’est le rôle actif du vendeur sur le prix. Il choisit le niveau de prix qu’il
estime lui être le plus favorable au lieu de laisser « jouer la concurrence ».
La première hypothése implicite de l’analyse de la «loi de l’offre et de la
demande » est l’absence de possibilité pour l’un des intervenants sur le
marché (vendeur ou acheteur) d’agir sur le prix du marché à lui seul... il
doit y avoir une infinité de vendeurs et d’acheteurs de petite dimension ou,
en d’autres termes, « atomicité » du marché.
Cette condition sous-jacente à l’analyse si elle est la plus visible n’est
pas la seule.
Ainsi, il faut que les produits soient homogènes, c’est-à-dire que
l’acheteur achète de façon indifférente le produit de la firme A ou celui de
la firme B; dans le cas contraire il pourra y avoir non pas un prix mais
8