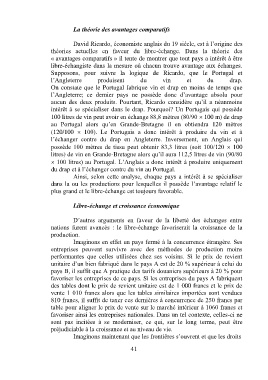Page 43 -
P. 43
La théorie des avantages comparatifs
David Ricardo, économiste anglais du 19 siécle, est à l’origine des
théories actuelles en faveur du libre-échange. Dans la théorie des
« avantages comparatifs » il tente de montrer que tout pays a intérêt à être
libre-échangiste dans la mesure où chacun trouve avantage aux échanges.
Supposons, pour suivre la logique de Ricardo, que le Portugal et
l’Angleterre produisent du vin et du drap.
On constate que le Portugal fabrique vin et drap en moins de temps que
l’Angleterre; ce dernier pays ne possède donc d’avantage absolu pour
aucun des deux produits. Pourtant, Ricardo considère qu’il a néanmoins
intérêt à se spécialiser dans le drap. Pourquoi? Un Portugais qui possède
100 litres de vin peut avoir en échange 88,8 mètres (80/90 100 m) de drap
au Portugal alors qu’en Grande-Bretagne il en obtiendra 120 métres
(120/100 100). Le Portugais a donc intérêt à produire du vin et à
l’échanger contre du drap en Angleterre. Inversement, un Anglais qui
possède 100 mètres de tissu peut obtenir 83,3 litres (soit 100/120 100
litres) de vin en Grande-Bretagne alors qu’il aura 112,5 litres de vin (90/80
100 litres) au Portugal. L’Anglais a donc intérêt à produire uniquement
du drap et à l’échanger contre du vin au Portugal.
Ainsi, selon cette analyse, chaque pays a intérêt à se spécialiser
dans la ou les productions pour lesquelles il possède l’avantage relatif le
plus grand et le libre-échange est toujours favorable.
Libre-échange et croissance économique
D’autres arguments en faveur de la liberté des échanges entre
nations furent avancés : le libre-échange favoriserait la croissance de la
production.
Imaginons en effet un pays fermé à la concurrence étrangère. Ses
entreprises peuvent survivre avec des méthodes de production moins
performantes que celles utilisées chez ses voisins. Si le prix de revient
unitaire d’un bien fabriqué dans le pays A est de 20 % supérieur à celui du
pays B, il suffit que A pratique des tarifs douaniers supérieurs à 20 % pour
favoriser les entreprises de ce pays. Si les entreprises du pays A fabriquent
des tables dont le prix de revient unitaire est de 1 000 francs et le prix de
vente 1 010 francs alors que les tables similaires importées sont vendues
810 francs, il suffit de taxer ces dernières à concurrence de 250 francs par
table pour aligner le prix de vente sur le marché intérieur à 1060 francs et
favoriser ainsi les entreprises nationales. Dans un tel contexte, celles-ci ne
sont pas incitées à se moderniser, ce qui, sur le long terme, peut être
préjudiciable à la croissance et au niveau de vie.
Imaginons maintenant que les frontiêres s’ouvrent et que les droits
41